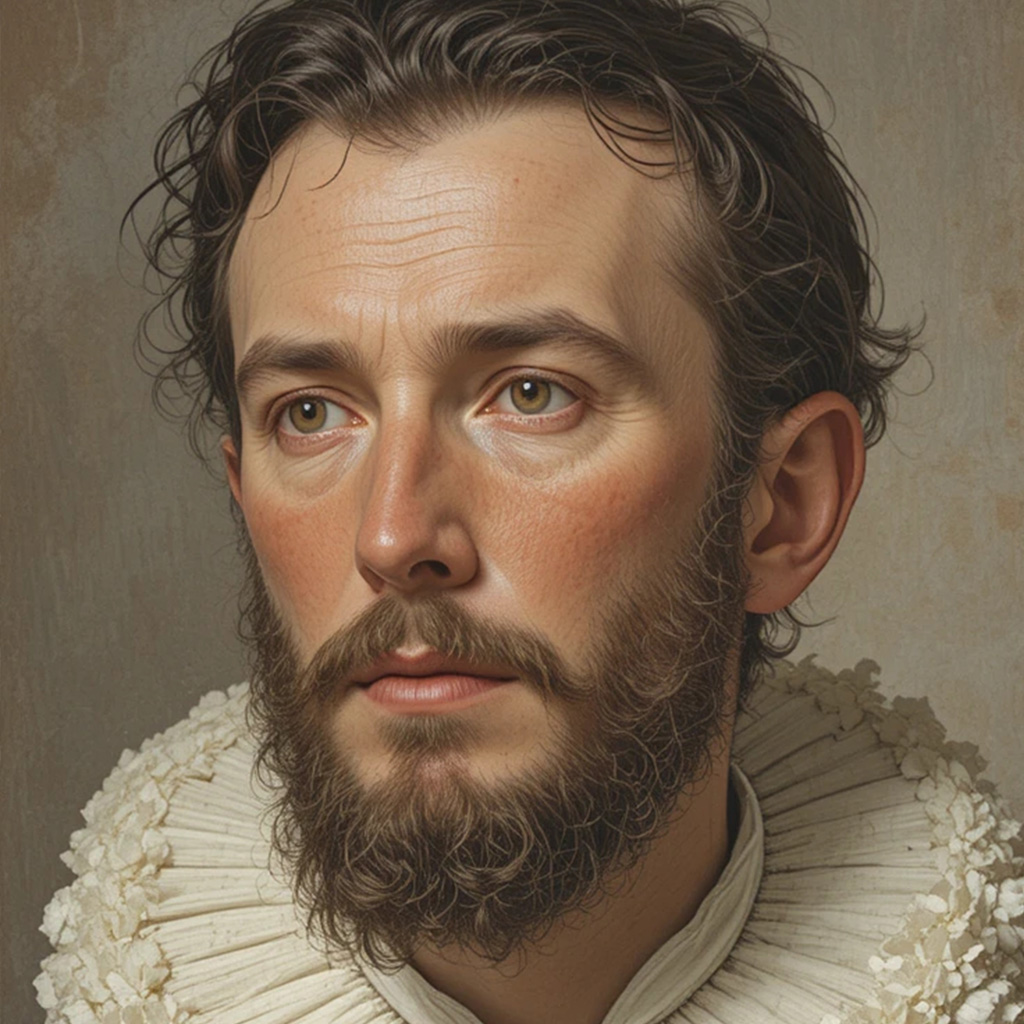Quand la Révolution renommait la France : l’histoire des noms de communes et l’ordonnance de 1814
- Histoire
- 11 juillet 2025
Pendant la Révolution française, des milliers de communes françaises ont vu leurs noms transformés pour effacer toute trace de christianisme, de royauté ou de féodalité. Mais que s’est-il vraiment passé ? Pourquoi certains noms n’ont duré qu’un mois, tandis que d’autres ont persisté ? Et l’ordonnance de Louis XVIII en 1814, souvent présentée comme un retour en force de l’Ancien Régime, était-elle vraiment aussi déterminante qu’on le prétend, ou s’agit-il d’une forme de propagande royaliste ? Plongeons dans cette fascinante page d’histoire.
Contexte des changements de noms en 1793-1794
Pendant la Révolution française, particulièrement sous la Convention nationale (1792-1795) et lors de la période de la Terreur (1793-1794), environ 3 000 communes françaises, soit environ 2 % des communes de l’époque, ont changé de nom pour effacer les références à l’Ancien Régime, à la royauté, à la féodalité et à la religion chrétienne. Ce mouvement s’inscrivait dans la politique de déchristianisation de l’an II (1793-1794), particulièrement intense entre octobre 1793 et juillet 1794, période marquée par une volonté d’éradiquer les symboles religieux et monarchiques. Un décret de la Convention nationale du 25 vendémiaire an II (16 octobre 1793) a formalisé cette injonction, invitant (ou plutôt obligeant) les communes à abandonner les noms évoquant la royauté (Roi, Reine, Royal), la féodalité (Château, Comte, Duc) ou le christianisme (Saint, Sainte, Église, Abbaye). Par exemple :
- Mont-Saint-Michel devient Mont-Michel ou Mont-Libre.
- Marly-le-Roi devient Marly-la-Machine.
- Saint-Malo devient Port-Malo.
- Lyon, jugée insuffisamment révolutionnaire, est rebaptisée Commune-Affranchie.
- Marseille devient brièvement Ville-sans-Nom.
Ces changements visaient à laïciser et républicaniser la toponymie, en remplaçant les noms par des références républicaines (Liberté, Égalité, Fraternité), révolutionnaires (Marat, Voltaire) ou géographiques (montagne, rivière). Cependant, tous les changements n’étaient pas durables : certains noms révolutionnaires ont été adoptés spontanément par les municipalités dès 1792, après la chute de la monarchie (10 août 1792), tandis que d’autres ont été imposés par la Convention en 1793. La durée de ces changements varie : certains n’ont duré que quelques mois (notamment en 1794, après la chute de Robespierre le 9 thermidor an II, 27 juillet 1794), d’autres ont persisté jusqu’au Consulat ou au-delà.
Le Bulletin des lois de 1801
Sous le Consulat, un arrêté du 5 fructidor an IX (23 août 1801) a mis fin à l’usage des noms révolutionnaires en exigeant que les communes reprennent les noms figurant dans les tableaux officiels de division du territoire. Cet arrêté visait à stabiliser l’administration et à mettre un terme aux changements toponymiques chaotiques de la Révolution. Cela signifie que, dès 1801, la majorité des communes avaient déjà repris leurs noms d’origine ou adopté des noms stabilisés, bien avant la Restauration de 1814. Par exemple, Montmorency, rebaptisée Émile en 1793, reprend son nom d’origine dès 1813, et Ferney-Voltaire abandonne le « Voltaire » entre 1802 et 1814. Ainsi, l’idée que certaines communes n’ont conservé leur nom révolutionnaire que pendant un mois en 1794 est plausible, car la réaction thermidorienne (post-juillet 1794) a entraîné un retour rapide aux noms d’origine dans de nombreux cas, surtout là où la déchristianisation était moins ancrée.
Cependant, environ 274 communes ont conservé leurs noms révolutionnaires sous le Consulat et l’Empire, et 86 d’entre elles les ont gardés ou repris après 1814, notamment dans des regiones comme la Bourgogne, l’Aube ou la Haute-Marne, où l’adhésion à la déchristianisation était plus forte. Par exemple, La Haye-Descartes (Indre-et-Loire) a conservé son nom révolutionnaire après 1814 et est devenue simplement Descartes en 1967.

L’ordonnance de Louis XVIII du 8 juillet 1814
Lors de la Première Restauration, Louis XVIII, revenu au pouvoir après l’abdication de Napoléon en avril 1814, promulgue une ordonnance le 8 juillet 1814 ordonnant que toutes les communes reprennent leurs noms d’avant 1790. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de la Restauration de « renouer la chaîne des temps » et d’effacer les traces de la Révolution et de l’Empire, tout en restaurant une monarchie de droit divin. La Charte de 1814, octroyée par Louis XVIII, reflète cette volonté de retour à l’Ancien Régime, tout en préservant certains acquis révolutionnaires comme la liberté de la presse ou la propriété.
Cependant, l’ordonnance de 1814 n’a pas eu l’impact radical que la propagande royaliste aurait pu laisser croire.
En effet :
- Beaucoup de communes avaient déjà repris leurs noms d’origine dès 1801 ou même avant, sous la réaction thermidorienne (1794-1795). L’ordonnance de Louis XVIII a donc surtout entériné une situation déjà largement en place.
- Certaines communes ont conservé leurs noms révolutionnaires, soit parce qu’ils étaient jugés neutres (par exemple, des noms géographiques), soit parce que l’adhésion locale à la Révolution restait forte. Par exemple, Ferney-Voltaire reprend son nom révolutionnaire en 1879, et La Haye-Descartes ne revient jamais à son nom d’origine.
- L’ordonnance ne concernait pas les communes dont les noms avaient été modifiés avant la Révolution pour des raisons féodales (par exemple, des villages renommés d’après leurs seigneurs). Ces cas, comme Albert (anciennement Ancre), ne sont pas directement liés aux changements révolutionnaires.
Propagande royaliste ou réalité historique ?
L’idée que l’ordonnance de Louis XVIII aurait été un acte majeur de restauration des noms d’avant 1790 peut être vue comme exagérée dans le cadre d’une propagande royaliste. Voici pourquoi :
- Contexte politique de la Restauration : Louis XVIII cherchait à légitimer son retour en présentant la Révolution comme une parenthèse à effacer. L’ordonnance du 8 juillet 1814 s’inscrit dans cette logique, en affirmant un retour à l’ordre ancien. En ce sens, elle a pu être amplifiée par la propagande royaliste pour magnifier l’action du roi, alors que la majorité des changements avaient déjà eu lieu sous le Consulat. Les posts sur X du 8 juillet 2025, qui soulignent l’annulation des « changements grotesques » par Louis XVIII, reflètent cette vision royaliste, mais ils simplifient la réalité historique.
- Impact limité de l’ordonnance : Puisque l’arrêté de 1801 avait déjà rétabli la plupart des noms d’origine, l’ordonnance de 1814 n’a fait que formaliser ce retour pour les communes récalcitrantes (environ 274 selon les sources). Elle n’a pas bouleversé la toponymie française de manière aussi spectaculaire que la propagande royaliste pourrait le laisser croire.
- Contre-exemple de la persistance des noms révolutionnaires : La survie de certains noms révolutionnaires, même après 1814, montre que l’ordonnance n’a pas été appliquée uniformément. Cela reflète des résistances locales ou une acceptation tacite de certains noms (comme Ferney-Voltaire ou Descartes).
Cependant, il ne faut pas totalement rejeter l’importance de l’ordonnance. Elle a eu un effet symbolique fort, en marquant la volonté de Louis XVIII de restaurer l’ordre monarchique et de rétablir une continuité avec l’Ancien Régime. De plus, dans certaines régions royalistes, comme à Lyon, où André-Suzanne d’Albon, maire en 1814, proclame la Restauration des Bourbons et demande même la révocation des députés ayant voté la mort de Louis XVI, l’ordonnance a pu être perçue comme un acte de réaffirmation monarchique.

Ce qui s’est réellement passé
En résumé, voici les faits :
- 1793-1794 : Environ 3 000 communes changent de nom sous l’impulsion de la Convention, dans le cadre de la déchristianisation et de l’effacement des symboles de l’Ancien Régime. Certains changements sont éphémères (quelques mois), d’autres plus durables.
- 1794-1795 (réaction thermidorienne) : Après la chute de Robespierre, de nombreuses communes reviennent spontanément à leurs noms d’origine, surtout celles où la déchristianisation était moins ancrée.
- 1801 : L’arrêté du 5 fructidor an IX (23 août 1801) ordonne le retour aux noms figurant dans les tableaux officiels, mettant fin à la plupart des noms révolutionnaires. Environ 274 communes conservent néanmoins leur nom révolutionnaire.
- 1814 : L’ordonnance de Louis XVIII du 8 juillet 1814 impose le retour systématique aux noms d’avant 1790, mais son impact est limité, car la majorité des communes avaient déjà repris leurs noms d’origine. Certaines communes, cependant, conservent ou reprennent des noms révolutionnaires après 1814.
- Propagande royaliste : La Restauration a amplifié l’importance de l’ordonnance de 1814 pour des raisons politiques, en présentant Louis XVIII comme le restaurateur de l’ordre ancien. Cela a pu donner l’impression que tous les changements de noms ont été annulés en 1814, ce qui est historiquement inexact.
Conclusion
L’histoire des noms des communes françaises montre à quel point la toponymie est un miroir des bouleversements politiques et culturels. Si certains noms révolutionnaires n’ont duré qu’un mois, d’autres ont laissé une empreinte durable, comme Ferney-Voltaire ou Descartes. L’ordonnance de 1814, loin d’être un tournant radical, a surtout formalisé un retour aux noms d’origine initié dès 1794 et consolidé en 1801
Alors, propagande royaliste ? En partie, oui, dans le sens où l’impact de l’ordonnance a été magnifié pour servir l’image de Louis XVIII. Mais la réalité est plus complexe : les changements de noms sous la Révolution, leur abandon progressif, et la persistance de certains noms révolutionnaires témoignent des tensions et des compromis d’une époque en pleine mutation.
Pour aller plus loin, explorez Les noms révolutionnaires des communes de France de Roger de Figuères (1901), disponible sur Archive.org, ou la liste détaillée sur Geneawiki. Et vous, saviez-vous que votre commune a peut-être eu un nom révolutionnaire ? Racontez-nous en commentaire !