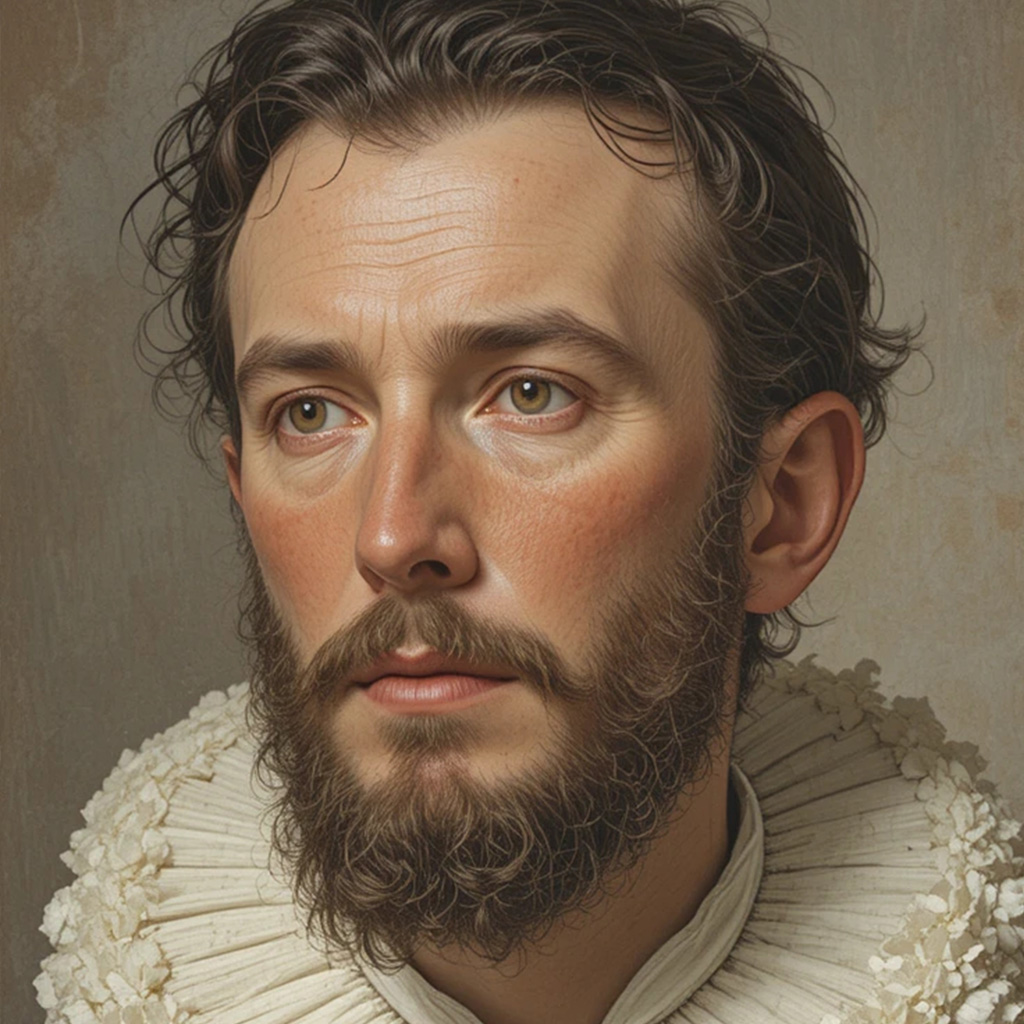Tentative d’Assassinat d’Édouard Ier en 1272 : Les Nizârites et les Mamelouks en Question
- Histoire
- 27 juillet 2025
Contexte historique
En 1271-1272, le prince Édouard d’Angleterre participe à la neuvième croisade, visant à soutenir les derniers bastions croisés en Terre sainte face à la montée en puissance du sultan mamelouk Baybars. Ce dernier, un chef militaire redoutable de la dynastie mamelouke bahrite, mène une campagne agressive contre les États latins d’Orient, en partie parce qu’ils se sont alliés aux Mongols, ennemis des Mamelouks. En 1272, Baybars conclut une trêve de dix ans avec les croisés, mais les tensions restent vives. Les Nizârites, connus pour leurs assassinats ciblés, sont alors un pouvoir régional influent, souvent en conflit avec les Mamelouks, mais parfois utilisés comme mercenaires ou alliés tactiques.
L’incident du 16 juin 1272 voit un ou plusieurs assaillants attaquer Édouard à Acre avec une arme empoisonnée, probablement un poignard. Édouard survit, mais est gravement blessé. Les récits contemporains et postérieurs divergent sur les détails, notamment sur l’identité des assaillants et leurs motivations.
Détails de l'événement
Selon les sources historiques, un ou plusieurs individus, prétendant vouloir se convertir au christianisme, auraient approché Édouard pour gagner sa confiance. Lors d’une rencontre, l’un d’eux aurait tenté de l’assassiner en le poignardant. Les chroniqueurs médiévaux rapportent que l’arme était peut-être enduite de poison, une pratique associée aux Nizârites, connus pour leur expertise dans les assassinats. Édouard parvient à se défendre, tuant son assaillant, mais la blessure nécessite des soins prolongés, et certaines légendes affirment que sa femme, Éléonore de Castille, aurait sucé le poison de la plaie, bien que cela relève probablement du mythe.
Les sources primaires ne confirment pas explicitement que les assaillants étaient des Nizârites, mais leur modus operandi (infiltration, arme empoisonnée, attaque ciblée) correspond à la réputation de cette secte. L’hypothèse d’une implication des Mamelouks, et particulièrement de Baybars, repose sur son intérêt stratégique à éliminer Édouard, un leader croisé charismatique capable de rallier des alliances avec les Mongols. Cependant, les Nizârites, qui venaient de perdre leur forteresse de Masyaf au profit de Baybars en 1272, avaient leurs propres raisons de s’en prendre aux croisés, souvent perçus comme des alliés des Mongols.

Analyse des sources
Sources chrétiennes médiévales :
- Les chroniqueurs chrétiens, comme Guillaume de Tyr (bien qu’il écrive avant l’événement) ou les continuateurs des chroniques croisées, décrivent les Nizârites comme des fanatiques utilisant des méthodes d’assassinat sophistiquées. Ces récits sont souvent biaisés, car les sources sunnites et chrétiennes dépeignent les Nizârites comme des « hérétiques » ou des « terroristes ». Par exemple, Joinville, chroniqueur de la septième croisade, mentionne des interactions entre Louis IX et le « Vieux de la Montagne » (le chef nizârite), suggérant que les Nizârites pouvaient être engagés comme mercenaires.
- Les récits chrétiens associent souvent les Nizârites à des couteaux empoisonnés ou à des actes publics spectaculaires pour semer la terreur, ce qui cadre avec l’attaque contre Édouard.
Sources musulmanes :
- Les historiens contemporains, comme Julien Loiseau, soulignent que les Mamelouks, sous Baybars, cherchaient à consolider leur pouvoir en éliminant les menaces croisées et mongoles. Une tentative d’assassinat contre Édouard, qui tentait de forger une alliance avec les Mongols, serait cohérente avec cette stratégie.
- Cependant, certains chercheurs, comme Peter Thorau dans The Lion of Egypt, notent que l’implication directe de Baybars reste spéculative, faute de preuves documentaires explicites. Les Nizârites могли agir de leur propre chef, motivés par leur opposition aux croisés ou par des pressions locales.
Sources modernes :
- Les historiens contemporains, comme Julien Loiseau, soulignent que les Mamelouks, sous Baybars, cherchaient à consolider leur pouvoir en éliminant les menaces croisées et mongoles. Une tentative d’assassinat contre Édouard, qui tentait de forger une alliance avec les Mongols, serait cohérente avec cette stratégie.
- Cependant, certains chercheurs, comme Peter Thorau dans The Lion of Egypt, notent que l’implication directe de Baybars reste spéculative, faute de preuves documentaires explicites. Les Nizârites могли agir de leur propre chef, motivés par leur opposition aux croisés ou par des pressions locales.
Points clés et incertitudes
- Rôle des Nizârites : Leur implication est probable en raison de leur réputation et de leur présence dans la région, mais les sources primaires ne confirment pas leur identité avec certitude. L’idée qu’ils prétendaient se convertir pour approcher Édouard est rapportée dans des récits chrétiens, mais peut refléter un stéréotype sur leur ruse.
- Commanditaire mamelouk : L’hypothèse que Baybars ait commandité l’attaque est séduisante, mais non prouvée. Baybars avait les moyens et le motif, mais les Nizârites, récemment soumis par lui, pouvaient aussi avoir agi pour d’autres raisons, comme protéger leurs propres intérêts face aux croisés ou aux Mongols.
- Date et contexte : L’événement est daté du 16 juin 1272 dans certaines sources, mais d’autres parlent du 17 ou 18 juin. La trêve de 1271 entre Baybars et les croisés rend l’attaque audacieuse, suggérant qu’elle visait à déstabiliser sans rompre officiellement l’accord.

Évaluation critique
Sources recommandées pour approfondir
Primaires :
- Ibn ‘Abd al-Zâhir, Al-Rawd al-zâhir fî sîrat al-Malik al-Zâhir (biographie de Baybars, Riyad, 1976).
- Al-Maqrizi, Histoire des sultans mamelouks de l’Égypte (trad. Quatremère, 1837).
- Joinville et chroniques croisées pour le contexte des Nizârites.
Secondaires :
- Peter Thorau, The Lion of Egypt: Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth Century (1992).
- Julien Loiseau, Les Mamelouks, XIIIe-XVIe siècle (2014).
- David Ayalon, Le phénomène mamelouk dans l’Orient islamique (1996).